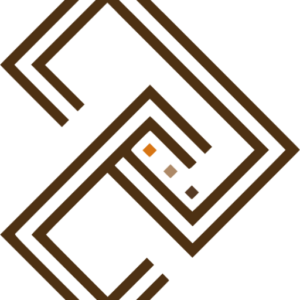Organisé par :
Jacob Jean-Pierre ;
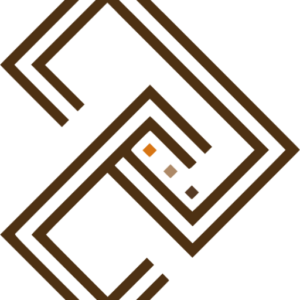
Selon E.P Thompson (2015), la coutume est lex loci. Elle n’est pas attachée aux personnes, elle est inscrite dans les lieux, dans la terre, dans le manoir qui la représente. Parler de la coutume et de la condition humaine organisée par la coutume c’est donc développer une perspective de la place, de l’habiter, du lieu, de l’art d’être situé quelque part dans le monde. En anthropologie, cette perspective du lieu, de l’habiter (dwelling), a particulièrement été développée par T. Ingold (1997, 2000, 2005) à partir d’une critique du naturalisme propre à une série d’auteurs (P. Descola, E. Viveiros de Castro), c’est-à-dire en partant de l’idée que la vie des êtres humains même encadrée par les institutions, ne se déroulait pas d’un côté d’une frontière entre société et nature qui serait elle-même organisée par ses propres lois. Pour T. Ingold, habiter, tenir une place, renvoie à un nexus de relations dynamiques constamment à produire à partir d’un flux de ressources sociales et naturelles car tous les êtres, humains et non humains, sont les passagers communs d’un monde dans lequel ils vivent, et contribuent constamment, en développant chacun leurs activités spécifiques, à définir les conditions d’existence des autres. Plus récemment, S. Vanuxem (2018) a perçu, en filigrane de la tradition civiliste, une conception de la propriété comme rapport d’habitation. Dans l’ancien droit romain, avant son durcissement par la théorie du dominium, la chose foncière possédée est une chose-lieu (par opposition à la chose-objet), la propriété étant d’abord la faculté d’habiter, déclinable en termes de droits, de biens ou de places occupées par les propriétaires dans les choses-milieux. Dans cette perspective, la propriété confère une position privilégiée au sein des choses, une place, des droits, ce qui ne signifie pas « un droit à la confiscation » pour le propriétaire mais un droit d’usage borné par l’existence d’autrui : l’habitant sans titre (y compris non humain), propriétaire d’un droit à l’existence, serait libre d’user les choses dans le respect des droits des propriétaires territoriaux privilégiés, mais ces derniers auraient, en retour, le devoir d’occuper leur place dans les limites du droit à l’existence de la communauté des autres habitants. Du fait du rapport de continuité, d’incorporation réciproque entre la chose et l’habitant de la chose dans ce type de contextes, il est facile de concevoir une inversion des rapports sujet/objet, et d’admettre que les choses-lieux puissent s’appartenir à elles-mêmes , c’est-à-dire être la source du droit, et que les personnes-habitants -jouets habituels d’opportunismes de toute nature et dont il faut donc se méfier- n’aient jamais la propriété des choses mêmes, mais seulement des places, des droits ou des biens en elles. S. Vanuxem veut appliquer cette formule à la défense des biens communaux ou sectionnels (en rapport avec l’article 542 du code civil) mais on signalera que c’est aussi la solution qu’adoptent les partisans de « l’animisme juridique » qui confèrent à des éléments de la nature menacés (le fleuve Whanganui en Nouvelle Zélande, le Gange en Inde, le Rio Atrato en Colombie..) le statut de sujets de droit.
Cette journée offrira des éclairages variés sur ces questions, autour d’études de cas en Afrique subsaharienne et à Madagascar, de travaux comparatifs sur l’état et l’évolution d’une pratique coutumière (lavente à réméré) ou de l’interprétation des usages communs dans la philosophie politique en Europe.
Les références bibliographiques sont disponibles dans le programme PDF