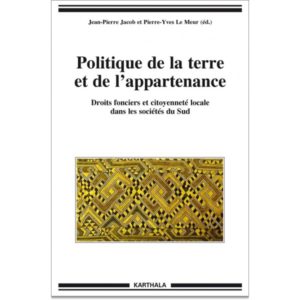Produites par des chercheurs d’origines diverses, travaillant dans des institutions européennes sur des terrains très variés (Amérique centrale et du Sud, Asie du Sud-est et du Sud, Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Sud, Madagascar, Nouvelle Calédonie…), les contributions de cet ouvrage s’organisent autour d’une réflexion sur la place de l’allocation des ressources foncières dans les dispositifs d’inclusion et de construction de la citoyenneté. Elles analysent la pluralité des lieux à partir desquels cette citoyenneté a pu se construire dans le passé ainsi que les transformations liées à la colonisation et au rôle de l’État – en tant que communauté d’appartenance nouvelle – dans les processus de déstructuration/restructuration qui les travaillent. La structuration ’organisation de l’ouvrage en trois parties cherche à rendre compte de différents angles d’approche de la problématique.
L’ouvrage commence par explorer les bases spatio-temporelles de la citoyenneté locale. Il souligne la pluralité historique des niveaux de régulation de l’accès aux ressources naturelles et les phénomènes de constitution (par imbrication) « d’humanité commune » qui en résultent. Il y est fait également état du processus progressif de restriction dans la définition de l’appartenance imposé par des dispositifs politico-légaux étatiques qui ont amené, dans les pays d’étude, à une contestation puis à une éradication des unités les plus englobantes, avec une tendance au recoupement des unités juridiques de mise à disposition des ressources et des unités économiques de production. Dans un deuxième temps, les auteurs analysent la situation de groupes dominés (réfugiés, squatters, minorité ethnique, minorité religieuse) dans leurs négociations actuelles pour la terre avec leurs États respectifs.
Ces négociations s’accompagnent d’un argumentaire de la reconnaissance qui renvoie, selon les cas et parfois de manière mêlée, soit à une politique de l’universalisme – les droits de l’homme, les droits de tout homme à bénéficier d’une protection et d’un accès à des ressources productives de la part de l’État –, soit à une politique de la différence liée à la reconnaissance des efforts accomplis par un groupe entretenant des rapports spécifiques avec un lieu investi et mis en valeur.
Enfin, l’ouvrage explore une problématique en quelque sorte inverse de celle développée précédemment. Sont présentés les phénomènes de recomposition d’anciennes communautés d’appartenance sous l’influence de politiques publiques pro-indigénistes (la Bolivie contemporaine d’Evo Moralès ; le Pérou des années 1968-1975 du général Velasco) en Bolivie et au Pérou, ou le challenge particulier posé en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte paradoxal de décolonisation négociée, pour construire la nation à partir d’une volonté d’articuler souveraineté locale et exigence d’intégration de populations et de projets non autochtones (la Nouvelle Calédonie après les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa).